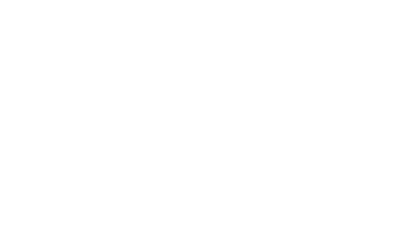Quand les destins d’une policière grecque et d’un réfugié syrien se croisent, leur façon de voir le monde change à jamais.
DEMAIN JE TRAVERSE
Un film de Sepideh Farsi
Sortie en salles : 15 juin 2022
2019 | Grèce/France/Luxembourg | Drame | 81 min | 1.85 | Dolby
couleur (DeLuxe) | VOSTF | Visa n°147 459
Maria est policière, grecque, mère célibataire et fille unique. Elle jongle avec ses problèmes d’argent, sa fille adolescente, sa vieille mère et la crise grecque qui fait qu’elle perd son poste à Athènes et doit accepter un poste sur l’île de Lesbos, au confins de la mer Egée. Yussof, un jeune syrien qui fuit la guerre pour ne pas être obligé de tuer, arrive à Lesbos et veut aller de l’avant en Europe. Yussof passe par Athènes où Maria est obligée de revenir, pour chercher sa fille qui a disparu. Leur destin se croise un bref moment dans une Grèce qui semble être une zone de paix, mais qui en réalité ne l’est pas. Celui qui semble être le plus libre des deux, l’est peut-être le moins.

— Galerie
ENTRETIEN DE SEPIDEH FARSI PAR PIERRE EISENREICH
Comment est née l’histoire de « Demain je traverse » ?
C’est un projet qui remonte à une dizaine d’années. Au départ, j’avais l’idée d’une histoire d’altérité, la rencontre improbable entre deux personnages venant de deux mondes différents. J’avais d’abord envisagé de tourner à Rome, puis cette histoire s’est déplacée dans le pourtour méditerranéen dans de vieilles cités comme Marseille. Finalement je l’ai réalisé entre Athènes et Mytilène pour filmer cette rencontre entre deux êtres que tout sépare, qui deviennent fusionnels, avant qu’ils ne se séparent à nouveau.
Est-ce que le contexte économique et social de la Grèce suite au remboursement de sa dette européenne, ainsi que le contexte de la guerre civile en Syrie ont aussi été des raisons premières pour raconter l’histoire de ce couple formé par Maria et Yussof ?
J’étais davantage intéressée par le contexte migratoire en Europe Centrale. Mais je le regardais à travers un point de vue français pour une histoire qui se situait à l’époque à Marseille. J’étais aussi préoccupée par l’idée d’une figure d’autorité des forces de l’ordre confrontée à celle du migrant. L’immigration française a beaucoup changé pendant le développement et l’écriture du scénario jusqu’aux phases concrètes de production. Il y a eu deux choses qui ont changé mon commentaire et qui ont influencé mon choix pour le lieu où se déroulerait l’histoire : j’avais entre- temps tourné deux films en Grèce, « Red Rose » (2014) et « Spiridoula, Marx, Dieu et Papandreou » (2016). J’ai été sensibilisée au contexte de la crise économique grecque alors que la situation migratoire s’aggravait due à l’augmentation du nombre de migrants, entre autres à cause de la guerre civile en Syrie et de la situation géopolitique au Moyen-Orient. J’étais plus impliquée dans ces deux contextes parallèles. Et Marseille avait depuis beaucoup changé. Du coup, j’ai placé mon histoire en Grèce.
Est-ce votre première fiction se déroulant en dehors de l’Iran ?
Oui, du moins en dehors du contexte iranien. C’est un exercice différent de créer des personnages qui sont éloignés de leur propre culture bien que je connaisse désormais davantage celle des Grecs. Mais étant donné qu’il s’agit d’une fiction et non d’un documentaire, l’exercice était plus périlleux de baser cette histoire sur une rencontre improbable et passionnelle entre une policière et un migrant. Il fallait donc que le personnage de Maria soit vraiment crédible en tant que policière. Grâce à ma pratique du documentaire, j’ai l’habitude d’aller chercher des éléments nouveaux et étrangers qui m’ont procuré ressources et informations. J’ai ainsi interrogé de nombreux policiers et migrants de différentes nationalités, dont des Syriens à Mytilène pour élaborer des personnages vraisemblables.
Comment avez-vous organisé et effectué vos repérages ? Je suppose que vous n’avez pas pu vous rendre sur le champ de bataille en Syrie…
Parallèlement à l’écriture du scénario, j’ai fait plusieurs voyages, notamment sur l’île de Lesbos dans le camp de Moria où j’aurais voulu tourner. Mais pour des raisons de sécurité il était impossible d’y venir avec une équipe de tournage. L’ambiance y était trop tendue à cause des conditions de vie des réfugiés. Un an avant le début du tournage, je suis partie seule à Diyarbakir à la recherche des paysages pour la traversée de la Turquie de mon personnage masculin, ainsi que pour faire la route jusqu’à la frontière syrienne où je voulais potentiellement tourner. Depuis Diyarbakir, des amis Kurdes m’ont accompagnée et nous avons traversés tout le Kurdistan turc jusqu’au checkpoint de Kobané. Pour la séquence du bateau, j’ai effectué le véritable trajet sur un navire normal jusqu’à Mytilène. J’ai même passé deux nuits dehors. Mais finalement, on ne tourne jamais exactement là où on le souhaiterait et le tournage a finalement eu lieu à Gaziantep. L’équipe grecque n’a pas voulu m’accompagner en Turquie, à cause des tensions qu’il y avait entre la Turquie et la Grèce en 2018. Donc j’ai tourné avec une équipe turque. Nous étions à une quarantaine de kilomètres de la zone de combat d’où nous entendions les tirs. Je pensais au début que c’était un tremblement de terre, mais en fait c’était l’artillerie turque, au moment où Erdogan avait décidé de frapper les positions kurdes en Syrie.
Est-ce que pendant le tournage, vous vous êtes retrouvés à certains moments dans la clandestinité à devoir « voler » certains plans ?
Dans le camp de réfugiés «Skaramangas», nous avons dû tourner plus ou moins en cachette, car il nous était impossible de le reconstituer avec des décors et des figurants. D’autres plans « volés » ont été faits depuis les trajets en voiture. J’aime procéder de cette façon car cela oblige à saisir les opportunités et à capter l’essence de la situation, alors que si on reconstitue tout, le contrôle de la scène fait perdre son aspect vivant. Pour la scène finale du film, lorsque nous avons tourné le retour à la zone de combat, le lieu n’était pas sécurisé et l’équipe était morte de trouille. Il fallait que nous filmions cette séquence sur une demi-journée afin de ne pas être appréhendés par la police. C’est encore la pratique du documentaire qui m’a habituée à cette agilité.
Comment avez-vous choisi les interprètes principaux ?
Pour le rôle de Maria, je connaissais Marisha Triantafyllidou que je suis depuis plusieurs films et que j’aime beaucoup. Mais au début je l’avais un peu écartée parce qu’elle a un visage extrêmement doux d’une beauté tranquille. Et je cherchais une certaine dureté pour le personnage de la policière. J’ai pour méthode d’éviter de faire des castings. Je préfère rencontrer individuellement les interprètes. Je vais également beaucoup au théâtre. J’ai donc vu plusieurs autres actrices et je suis revenue vers Marisha en lui proposant d’aller contre sa douceur innée. Pour trouver l’interprète de Yussof, les choses furent plus compliquées. C’était il y a quatre ans et je ne trouvais pas de jeunes acteurs de sa génération. J’ai rencontré un réalisateur syrien qui avait créé un festival dans la zone libre syrienne où était programmé mon documentaire, «Téhéran sans autorisation». Il m’a conseillé de prendre contact via internet avec tout un groupe de jeunes acteurs issus de l’école d’art dramatique de Damas qui étaient pour la plupart déjà réfugiés en Europe. Hanna Issa que j’ai choisi finalement se trouvait à l’époque à Vienne. Il avait fait le même trajet que tous les migrants syriens, en passant par la Grèce. Je l’ai choisi après qu’il m’ait envoyé plusieurs vidéos tests. Puis je l’ai fait venir à Athènes afin qu’il rencontre Marisha et j’ai vu que l’alchimie pouvait opérer entre eux deux.
Comment avez-vous mis vos deux interprètes principaux en condition ?
Je les ai fait répéter ensemble pendant un mois et demi. Mais je savais que Hanna possédait déjà la base de son personnage puisqu’en réalité il était déjà passé par Mytilène. Il m’avait d’ailleurs montré beaucoup de vidéos de son périple. Il y avait aussi ces films issus d’un collectif anonyme de réalisateurs syriens (Abounaddara) qui m’ont permis de me documenter et m’ont aidé pendant l’écriture du scénario. Pour le rôle de Maria, Marisha a travaillé pour adopter cette démarche policière. Le costume et l’uniforme ont aussi été prépondérants pour elle grâce à ma formidable costumière grecque Mayou Trikerioti. Elle lui a donné pour son allure de civil un blouson qui évoque aussi son uniforme de policière. Il m’arrive aussi de donner des vêtements à mes personnages, parfois une bague ou une montre, comme si les personnages émanaient d’une partie de moi.
Comment s’est effectuée votre collaboration avec Erik Truffaz pour la bande originale de « Demain, je traverse » ?
Erik est un musicien que j’apprécie beaucoup. J’adore le son de sa trompette, qui rappelle pour moi celui d’une voix humaine. Je l’avais d’abord contacté pour mon projet de film d’animation qui prenait plus de temps que prévu à produire. Je le connaissais davantage comme musicien de jazz que pour sa musique de film. Je lui ai donc proposé de faire un essai en lui faisant lire au préalable le scénario pour voir si la thématique l’intéresserait. Il a aimé l’histoire et a commencé à composer avant le tournage d’abord pour trompette seule, mais aussi avec orchestre pour certaines scènes. Je souhaitais qu’il y mette en avant sa sensibilité de jazzman. Sa musique m’a ainsi imprégnée pendant le tournage et m’a aidé à trouver le rythme de certaines scènes. Pendant le montage, il a opéré d’autres essais de composition en ajoutant des cordes, des sons électro, en s’inspirant aussi de musiques et chansons iraniennes que je lui ai fait écouter. Il a même utilisé la voix de ma fille, Darya, pour un morceau basé sur un chant folklorique perse.
A propos de Sepideh Farsi
Née à Téhéran en Iran, Sepideh Farsi s’installe à Paris en 1984 pour étudier les mathématiques. Après plusieurs années de photographie, elle commence à réaliser des courts-métrages et des documentaires, parmi lesquels «Téhéran sans autorisation» en 2009 et «Harat» en 2017, tous deux présentés à Locarno.
Elle réalise ses premiers long-métrages «Rêves de sable» (2003) et «Le regard» (2005), sélectionnés à Rotterdam.
En 2010, elle réalise «La maison sous l’eau» et le documentaire «Cloudy Greece» en 2012 avant de présenter «Red rose» en première mondiale au Festival de Toronto en 2014. «Demain je traverse» est son nouveau film.