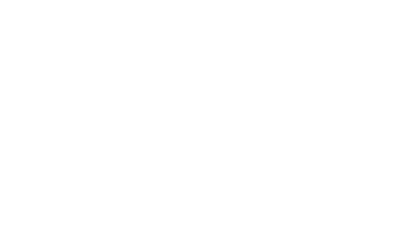SAMEDI SOIR DIMANCHE MATIN
Un film de Karel REISZ
Sortie en salles : 4 octobre 2017
Visa n°24865
Royaume-Uni – 1961 |
1h29 |
N&B / 1,66
Ouvrier tourneur dans une usine de Notthingham, Arthur Seaton oublie son travail abrutissant quand arrive le week-end. Là, il partage son temps entre le pub où la bière coule à flots, le lit de son amante Brenda, une femme mariée à l’un de ses collègues et les parties de pêche. Alors qu’il vient de rencontrer une belle jeune fille, Brenda lui annonce qu’elle est enceinte de lui. Cette nouvelle bouleverse le jeune homme qui va devoir ce sortir de ce mauvais pas.

— Galerie
Du bon temps, rien que du bon temps :
Film-manifeste du Free Cinema britannique, Samedi soir, dimanche matin est une œuvre totalement révolutionnaire dans l’Angleterre des années 60. Car le spectateur découvre alors, stupéfait, une vision inédite du monde ouvrier. Il n’est plus ici question d’une classe sociale victime du capitalisme et inspirant la compassion : Arthur, personnage emblématique de son milieu, boit copieusement avec ses copains, sort avec une femme mariée, drague une jeune fille et, surtout, affiche une forme de détermination et d’assurance qui n’incite guère à le contrarier. Comme il le dit lui-même, « Moi, ce que je cherche, c’est à me payer du bon temps, tout le reste n’est que de la propagande ! » La grande réussite de Karel Reisz, c’est d’éviter soigneusement toute psychologisation des rapports entre les personnages et de s’inscrire résolument dans un cinéma de l’action : même si ses décisions sont parfois inconséquentes, Arthur prend sa vie en main et va de l’avant. Autant dire qu’en abordant l’adultère et l’avortement sans point de vue moralisateur, le cinéaste bousculait les conventions sociales de l’époque.
Si Samedi soir, dimanche matin a autant marqué les esprits, c’est aussi parce qu’il exalte l’individualisme de la jeunesse dans une société encore profondément corsetée. Arthur apparaît ainsi comme un électron libre, désireux d’échapper au conformisme et, surtout, à l’intégration, voire à la disparition, dans le collectif. Il se démarque très nettement de la génération de son père, symbolisée par sa passivité devant l’écran de télévision, et se rebelle même contre la société dépositaire d’un ordre moral et de valeurs petite-bourgeoises qu’il a en horreur : il faut le voir tirer une balle – à blanc – sur une voisine fouineuse ou prendre la défense d’un pauvre homme contre lequel une foule haineuse s’est liguée. Partisan d’un hédonisme sans limite, Arthur se méfie de la consommation de masse et du développement rapide des logements HLM : alors que sa petite amie y voit l’espoir de meilleures conditions de vie, le protagoniste constate, avec tristesse, que c’est surtout le signe d’une urbanisation sauvage.
Formidablement moderne, Reisz distille les ingrédients du mélodrame – le poids du destin et du hasard à travers la grossesse non désirée et la rencontre fortuite à la fête foraine –, mais il en évite tous les poncifs grâce à un réalisme sans concession. C’est ainsi qu’il est constamment dans la retenue : pas d’effusion émotionnelle, ni de musique symphonique venant souligner les rebondissements de l’intrigue, ni de lyrisme dans la mise en scène. L’interprétation d’Albert Finney contribue également à ce sentiment de crudité : massif et charismatique, avec ce visage carré si particulier, il impose une présence magnétique indissociable du personnage d’Arthur. Une œuvre visionnaire et fascinante.
Albert Finney : Le caméléon magnifique
Comédien protéiforme, Albert Finney a toujours marqué les esprits par sa capacité sidérante à se glisser dans la peau de ses personnages, quel que soit leur âge, leurs origines ou leur profession. En plus de quarante ans de carrière, il aura ainsi incarné un pape polonais, un détective belge, un gangster irlandais, un avocat américain, un roi écossais et un guerrier romain !
Né en 1936 dans un milieu ouvrier, il fréquente la prestigieuse Royal Academy of Dramatic Arts, puis se produit sur scène dans le répertoire shakespearien. Lui qui a grandi dans une région industrielle frappée par les injustices sociales et les difficultés économiques était destiné à camper Arthur dans Samedi soir et dimanche matin (1960) de Karel Reisz : plébiscité par la critique, il décroche le rôle principal de Tom Jones (1963) de Tony Richardson, où il fait sensation en libertin fort en gueule.
Quatre ans plus tard, il donne la réplique à Audrey Hepburn dans Voyage à deux de Stanley Donen. Passant d’un registre à l’autre, il interprète un passionné d’art moderne dans The Picasso Summer (1969), un personnage de Dickens dans Scrooge (1970), le célèbre détective Hercule Poirot dans Le crime de l’Orient-Express (1974), un chasseur de loup-garou dans Wolfen (1981) et un chirurgien esthétique dans Looker (1981). Mais c’est avec L’usure du temps (1982) d’Alan Parker qu’il décroche une citation à l’Oscar, puis une deuxième pour L’habilleur (1983) de Peter Yates où il interprète un comédien shakespearien. Dans cette période faste de sa carrière, il remporte une troisième nomination à l’Oscar pour Au-dessous du volcan (1984) de John Huston. La même année, il est salué pour son interprétation du pape Jean-Paul II dans un téléfilm américain.
Privilégiant les productions indépendantes, il est à l’affiche du magnifique Miller’s Crossing (1990) des frères Coen, des leçons de la vie (1994) de Mike Figgis et d’Un couple peu ordinaire (1998) de Paul Seed. En 2000, on le retrouve au sommet de sa forme en avocat humaniste dans Erin Brockovich de Steven Soderbergh – aux côtés de Julia Roberts – qui lui vaut une nouvelle citation à l’Oscar. Après Big Fish (2003) de Tim Burton, il tourne dans La vengeance dans la peau (2007) de Paul Greengrass et tient un rôle bouleversant dans 7h58 ce samedi-là, ultime – et sublime – chef d’œuvre de Sidney Lumet. On l’a récemment vu dans Skyfall (2012) de Sam Mendes et Jason Bourne : l’héritage de Tony Gilroy.
Karel Reisz : Le peintre de l'insoumission
Cofondateur avec Lindsay Anderson et Tony Richardson du Free Cinema anglais, Karel Reisz a souvent mis en scène l’individualisme forcené de personnages rebelles. Né en 1926 en Tchécoslovaquie, il débarque en Angleterre à l’âge de 12 ans juste avant l’invasion de son pays par les nazis : il sera le seul de sa famille à survivre à la Shoah. Après avoir servi dans la Royal Air Force pendant la guerre, il fait des études de chimie, puis se tourne vers la critique de cinéma au début des années 50. C’est à cette époque qu’il écrit The Technique of film Editing, petit manuel explorant toute la richesse du montage, encore lu aujourd’hui. En 1955, il coréalise avec Tony Richardson Momma Don’t Allow, court métrage documentaire tourné dans un club de jazz. Cinq ans plus tard, il signe son premier long métrage, Samedi soir et dimanche matin, portrait d’un homme issu de la classe ouvrière qui refuse d’être le jouet du système.
Après avoir produit Le prix d’un homme (1963) de Lindsay Anderson, autre œuvre majeure du Free Cinema, il réalise le mélodrame La force des ténèbres (1964) où Albert Finney campe un psychopathe conservant la tête de l’une de ses victimes dans une boîte à chapeaux. Deux ans plus tard, Morgan brosse le portrait décalé d’un artiste hostile au conformisme bourgeois, mais incapable d’adhérer à l’idéologie communiste de sa mère. Avec Isadora (1968), Reisz s’attaque à un autre personnage de rebelle – une femme, cette fois : la danseuse Isadora Duncan qui fréquenta les révolutionnaires russes au début du XXème siècle. Le cinéaste enchaîne avec Le Flambeur (1974), autour d’un prof d’université accro au jeu, et Les guerriers de l’enfer (1977), évocation d’un vétéran de la guerre du Vietnam qui, de retour au pays, découvre une Amérique en proie à la drogue et à la pornographie.
C’est en 1981 que Reisz connaît son plus grand succès avec La maîtresse du lieutenant français, adaptation d’un roman de John Fowles située au XIXème siècle. Meryl Streep y incarne une femme qui refuse de se plier aux conventions rigides de l’ère victorienne. En 1985, il tourne Sweet Dreams, biopic autour de la chanteuse de country Patsy Cline, et cinq ans plus tard, Chacun sa chance sur un scénario d’Arthur Miller, thriller qui laisse malheureusement le public indifférent. Karel Reisz se détourne alors du cinéma pour se consacrer au théâtre : ses mises en scène d’Ibsen et Pinter sont plébiscitées par la critique. Il disparaît en 2002.
Le Free Cinema : un renouveau salutaire
On a souvent tendance à comparer le Free Cinema anglais à la Nouvelle Vague française. Sans doute parce qu’ils sont nés à la même époque et qu’ils ont en partage le refus des conventions sociales et le goût pour les audaces formelles. Mais il n’est pas inutile de revenir sur les origines de ce mouvement esthétique et politique britannique particulièrement influent.
Au départ, le Free Cinema est le titre attribué à un programme de documentaires réalisés entre 1956 et 1959 par de jeunes cinéastes comme Lindsay Anderson, Tony Richardson, et Karel Reisz qui avaient du mal à projeter leurs films chacun de leur côté. Ils avaient alors décidé de se regrouper, constatant qu’une « démarche commune » les unissait. Anderson forgea l’expression « Free Cinema » pour montrer que lui et ses confrères s’affranchissaient de toute considération commerciale et politique. Résultat : le succès, inattendu, pérennisa l’opération et consacra le Free Cinema comme le manifeste d’un mouvement rejetant le conservatisme du cinéma anglais. Le regard stéréotypé et condescendant sur la classe ouvrière et la déconnection entre la réalité sociale du pays et les films étaient régulièrement fustigés. Les « angry young men » – ces jeunes artistes révoltés par l’immobilisme du Royaume-Uni – tentent d’adopter un point de vue plus objectif, quoique respectueux et tendre, sur les milieux populaires. Pour autant, ils défendent la liberté absolue du cinéaste d’exprimer son point de vue intime sur le monde. « Aucun film ne saurait être trop personnel », rappelaient-ils dans le texte fondateur du mouvement.
Produites de manière indépendante dans des conditions semi-professionnelles, les œuvres du Free Cinema sont le plus souvent tournées en noir et blanc et caméra à l’épaule, bannissent ou limitent le recours à une voix-off jugée didactique et bousculent volontiers la linéarité du récit. Comme les auteurs de la Nouvelle Vague, les cinéastes anglais du Free Cinema privilégient les décors naturels pour être au plus près de la réalité du pays, tournent avec de petites caméras portatives 16 mm et évitent le plus souvent les éclairages artificiels.
Même si le Free Cinema a été moins universellement reconnu que le néoréalisme italien ou la Nouvelle Vague, il a malgré tout imprégné le cinéma d’auteur anglais des années 60. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si Tony Richardson, Karel Reisz et Lindsay Anderson se tournent alors vers la fiction et poursuivent leur exploration, souvent dans un style naturaliste, de la société britannique pour en dénoncer les rigidités. Samedi soir et dimanche matin (1960), La solitude du coureur de fond (1962) et If… (1968) s’imposent rapidement comme les manifestes de cette nouvelle tendance du cinéma anglais, enfin dépoussiéré !
TEXTES : Franck GARBARZ