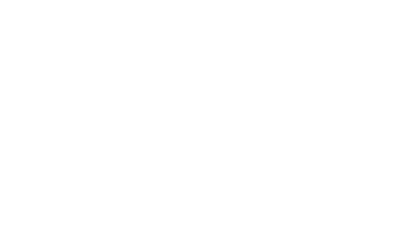UN GOUT DE MIEL
Un film de Tony RICHARDSON
Sortie en salles : 18 octobre 2017
Visa n°27189
Royaume-Uni – 1961 |
1h40 |
N&B/1,66
Jo, une petite collégiène un peu gauche, vit à Manchester avec sa mère Helen qui se soucie plus de trouver un nouvel amant que de s’occuper de sa fille. Un soir que sa mère l’a mise dehors pour vivre une nouvelle aventure amoureuse, Jo vit une brève idylle avec un marin noir. Enceinte et abandonnée par sa mère qui s’est mariée, elle rencontre Geoffrey, jeune homosexuel qui lui propose de vivre à ses côtés. Mais la mère ne l’entend pas de cette oreille…

— Galerie
Assoifés d'amour
Centré sur des personnages de femmes, Un goût de miel est une œuvre à part au sein du Free Cinema. Il y a bien entendu la protagoniste, Jo, un rien garçonne, qui crie son manque d’amour à la face du monde. Et aussi Helen, sa mère, monstre d’égoïsme dont, malgré tout, on comprend qu’elle a dû se battre dans un monde foncièrement sexiste. De manière plus frontale que dans les films du même courant, Tony Richardson aborde des thématiques explosives dans l’Angleterre conservatrice du tout début des années 60 : la quasi prostitution de la mère, femme d’âge mûr, pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille, la frigidité, la grossesse adolescente, la mixité raciale et l’homosexualité. Pourtant, jamais le cinéaste ne donne le sentiment d’être dans l’outrance et la volonté de choquer le spectateur. Il s’attache seulement à retracer, sans apprêt, le parcours de personnages inscrits dans un contexte socioéconomique bien particulier. Issues du monde ouvrier, les deux femmes luttent constamment pour leur survie et ne peuvent se permettre de s’embarrasser de convenances sociales. Résultat : elles parlent crû, elles parlent vrai, elles parlent sans détour. Et elles font preuve de moins de préjugés que les bourgeois. En témoigne l’attitude de Jo, d’abord intriguée, puis bienveillante, à l’égard de l’homosexualité de Geoffrey.
Entre la mère et la fille, les échanges sont âpres et vifs, voire violents. Comme Helen ne s’est jamais vraiment occupée de Jo, ni même souciée de son bien-être, la jeune fille ne la ménage pas. Cinglante, elle lui jette au visage son âge et le dégoût qu’elle lui inspire et l’accable de reproches. En retour, la mère, très peu maternelle, la sacrifie pour vivre avec son amant, appelé à devenir son mari. Cependant, il subsiste un attachement indéfectible de l’une pour l’autre qui transparaît dans la scène où Helen tente de prendre soin de Jo enceinte. C’est d’ailleurs cette tendresse, émouvante, que l’on retient des rapports entre les personnages. D’abord entre Jo et le marin noir. Puis, surtout, entre la jeune fille et Geoff, tous deux assoiffés d’amour. Réinventant une figure de couple inédite, ils inversent les rôles traditionnellement impartis à l’homme et à la femme : tandis qu’elle gagne l’argent du ménage – et paie le loyer, comme elle le rappelle fièrement –, lui s’occupe de la sphère domestique. Bien entendu, ce couple tragiquement impossible est voué à éclater à brève échéance. Mais Jo et Geoff auront au moins été heureux l’espace d’un instant.
Si le film est la libre adaptation d’une pièce de théâtre, Richardson en a évité tous les écueils : Un goût de miel est une authentique œuvre de cinéma. Il suffit, pour s’en convaincre, de voir l’étrange onirisme qui se dégage du paysage industriel où évoluent les personnages. À ce titre, les adieux de Joe à son marin, qui disparaît progressivement à l’horizon, sont d’une beauté stupéfiante. La jeune Rita Tushingham, qui campe la protagoniste, est épatante avec sa gouaille, sa rage contenue et ses grands yeux qui ne demandent qu’une chose – qu’on l’aime, tout simplement.
Deux formidables comédiennes
Rita Tushingham
Fille d’épicier, Rita Tushingham s’impose comme la première vraie comédienne du New Cinema anglais. Avec ses cheveux noirs, ses grands yeux interrogateurs et son allure gauche, elle n’était pas vraiment belle, mais correspondait parfaitement aux rôles de la Nouvelle Vague des années 60. Formidable dans Un goût de miel (1961) de Tony Richardson, elle décroche un BAFTA de la révélation et séduit le public et la critique. En 1963, elle remporte le New York Film Critics Award avec The Leather Boys de Sidney J. Furie. Puis, elle enchaîne avec La fille aux yeux verts où son côté décalé et sa timidité font mouche. On la retrouve en orpheline fragile dans Le docteur Jivago (1965) de David Lean et en jeune provinciale dans Le Knack… et comment l’avoir (1965) de Richard Lester. Elle campe encore une jeune hippie dans Le gourou (1969) de James Ivory, réflexion critique sur la contre-culture des années 60.
Elle se fait plus rare dans les décennies ultérieures, même si on la remarque dans A Judgement in Stone (1986) et An Awfully Big Adventure (1995) de Mike Newell.
Dora Brya
Très populaire dans les années 40 et 50, Dora Bryan, née en 1924, s’est d’abord produite pour l’armée anglaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a souvent joué les filles gouailleuses et peu raffinées, comme dans Première désillusion (1948) de Carol Reed, The Cure for Love (1950) et Time Gentlemen Please! (1952) de Lewis Gilbert.
Elle se démarque nettement de son registre comique avec Un goût de miel (1961) de Tony Richardson où son interprétation d’une mère égocentrique lui vaut un BAFTA Award. Si elle tourne encore quelques films, et notamment dans La fille de Jack l’éventreur (1971), elle s’illustre surtout au théâtre à Londres et à Broadway. Elle disparaît en 2014, à l’âge de 90 ans.
Le Free Cinema : un renouveau salutaire
On a souvent tendance à comparer le Free Cinema anglais à la Nouvelle Vague française. Sans doute parce qu’ils sont nés à la même époque et qu’ils ont en partage le refus des conventions sociales et le goût pour les audaces formelles. Mais il n’est pas inutile de revenir sur les origines de ce mouvement esthétique et politique britannique particulièrement influent.
Au départ, le Free Cinema est le titre attribué à un programme de documentaires réalisés entre 1956 et 1959 par de jeunes cinéastes comme Lindsay Anderson, Tony Richardson, et Karel Reisz qui avaient du mal à projeter leurs films chacun de leur côté. Ils avaient alors décidé de se regrouper, constatant qu’une « démarche commune » les unissait. Anderson forgea l’expression « Free Cinema » pour montrer que lui et ses confrères s’affranchissaient de toute considération commerciale et politique. Résultat : le succès, inattendu, pérennisa l’opération et consacra le Free Cinema comme le manifeste d’un mouvement rejetant le conservatisme du cinéma anglais. Le regard stéréotypé et condescendant sur la classe ouvrière et la déconnection entre la réalité sociale du pays et les films étaient régulièrement fustigés. Les « angry young men » – ces jeunes artistes révoltés par l’immobilisme du Royaume-Uni – tentent d’adopter un point de vue plus objectif, quoique respectueux et tendre, sur les milieux populaires. Pour autant, ils défendent la liberté absolue du cinéaste d’exprimer son point de vue intime sur le monde. « Aucun film ne saurait être trop personnel », rappelaient-ils dans le texte fondateur du mouvement.
Produites de manière indépendante dans des conditions semi-professionnelles, les œuvres du Free Cinema sont le plus souvent tournées en noir et blanc et caméra à l’épaule, bannissent ou limitent le recours à une voix-off jugée didactique et bousculent volontiers la linéarité du récit. Comme les auteurs de la Nouvelle Vague, les cinéastes anglais du Free Cinema privilégient les décors naturels pour être au plus près de la réalité du pays, tournent avec de petites caméras portatives 16 mm et évitent le plus souvent les éclairages artificiels.
Même si le Free Cinema a été moins universellement reconnu que le néoréalisme italien ou la Nouvelle Vague, il a malgré tout imprégné le cinéma d’auteur anglais des années 60. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si Tony Richardson, Karel Reisz et Lindsay Anderson se tournent alors vers la fiction et poursuivent leur exploration, souvent dans un style naturaliste, de la société britannique pour en dénoncer les rigidités. Samedi soir et dimanche matin (1960), La solitude du coureur de fond (1962) et If… (1968) s’imposent rapidement comme les manifestes de cette nouvelle tendance du cinéma anglais, enfin dépoussiéré !
TEXTES : Franck GARBARZ