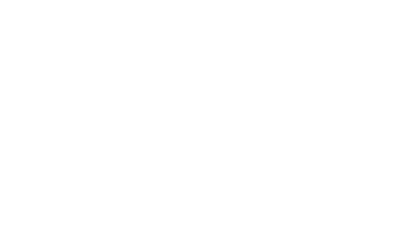PRIX LOUIS DELLUC 1958
MOI UN NOIR
Un film de Jean ROUCH
Sortie en salles : 12 octobre 2016
Visa n°21383
Documentaire |
|
Année: 1957 |
|
1h12 / Couleurs/Mono |
|
Nationalité: Française
Trois Nigériens et une Nigérienne s’installent à Treichville, banlieue d’Abidjan, chef-lieu de la Côte d’Ivoire. Comme nombre de leurs compatriotes, ils tentent l’aventure de la ville…Amère aventure pour ceux qui abandonnent leur village et se heurtent à une civilisation mécanisée.

— Galerie
À PROPOS
Avec ce film, Jean Rouch quitte tout à fait le domaine de l’ethnologie traditionnelle:
« J’ai suivi un petit groupe de jeunes émigrés nigériens à Treichville, faubourg d’Abidjan.Je leur ai proposé de faire un film où ils avaient le droit de tout faire et de tout dire. Alors nous avons improvisé un film ».
Le récit picaresque d’Edward G. Robinson
Avec cette œuvre foisonnante et inclassable tournée à l’aube de la Nouvelle Vague, le maître du documentaire ethnographique brouille résolument la ligne de partage entre le cinéma scientifique et la fiction. Comme l’explique Jean Rouch : “Pendant six mois, j’ai suivi un petit groupe de jeunes Nigériens à Treichville. Je leur ai proposé de faire un film où ils joueraient leur propre rôle et où ils auraient le droit de tout faire et de tout dire. C’est ainsi que nous avons improvisé ce film.” À partir de ce dispositif inédit, le cinéaste s’attache à la trajectoire d’un jeune homme originaire de Niamey, venu à Abidjan pour trouver du travail. Se faisant appeler “Edward G. Robinson”, il raconte en voix-off qu’il est manœuvre journalier à la merci des employeurs. Grâce à la tonalité joyeuse du protagoniste et à l’enchaînement rythmé des images, Rouch évite systématiquement le discours engagé si prévisible de ce type d’entreprise : en suscitant une empathie dépourvue du moindre paternalisme colonialiste pour Robinson, le réalisateur livre pourtant un point de vue politique d’une grande subtilité. Car il dénonce l’exploitation des Nigériens, traités comme des sous-hommes, par les entreprises ivoiriennes. Autrement dit, l’instrumentalisation d’Africains par d’autres Africains. Un constat implacable.
Pour autant, la dramaturgie s’immisce souvent dans les interstices du documentaire. Car Rouch laisse Robinson mener le récit – son récit – et nous raconter le déroulement de sa semaine. On rencontre ainsi ses copains, comme “Eddie Constantine” et “Tarzan”, et la femme qu’il rêve d’épouser, dont le surnom de star hollywoodienne – Dorothy Lamour – est une invitation au voyage. La bande-son, qui se rapproche davantage du commentaire en voix-off que du dialogue, participe également à la fiction. Bien qu’enregistré en direct, le son n’était pas synchrone : “Trois mois après le tournage, je suis retourné en Côte d’Ivoire et devant les images Robinson et Eddie Constantine ont improvisé un texte, pour moi ébouriffant. (…) Ils revivaient complètement cette histoire, ils la réinventaient. (…) Pour moi, c’était la découverte presque sacrée du cinéma”, confie le cinéaste. Robinson nous entraîne alors dans une déambulation d’une totale liberté à travers Abidjan où l’on découvre les quartiers pauvres, le bord de mer, un lac propice à la baignade, un cabaret, etc. En nous emmenant au port, il nous fait même voyager grâce aux noms évocateurs des bateaux – Oslo, Hambourg, Rouen, Rochefort – qui lui rappellent son propre parcours. On reste ému par les moments de bonheur et d’insouciance du samedi soir, rares instants volés à la galère du quotidien, où Robinson peut se réinventer en boxeur émérite et en amant magnifique. Un chef d’œuvre.
Jean Rouch : La fiction, comme arme du documentaire
Grand maître du documentaire ethnographique, Jean Rouch est l’auteur de plus de 120 films qui ont totalement redéfini la conception moderne du cinéma scientifique. Né en 1917, il découvre l’Afrique en 1941 alors qu’il est ingénieur des Ponts et Chaussées. Six ans plus tard, il tourne son premier court métrage, Au pays des mages noirs. En 1952, il fonde avec André Leroi-Gourhan le comité du film ethnographique, puis il signe avec Les Maîtres fous (1954) sa première œuvre majeure : on y découvre les rites de possession du Niger comme on ne les a encore jamais vus. Dès lors, Rouch parle de “ciné-transe”, dispositif de tournage caméra à l’épaule impliquant la participation du réalisateur aux événements filmés. Autant dire qu’il assume sa subjectivité et son empathie pour les “personnages” de ses documentaires. Il est vivement critiqué par la communauté scientifique pour son mélange des genres.
Par la suite, de Moi, un Noir (1958) à La chasse au lion à l’arc (1965), de Jaguar (1967) à Cocorico, monsieur Poulet (1974), il fait de plus en plus se côtoyer cinéma du réel et fiction, n’hésitant pas à recourir à l’improvisation et à solliciter la participation de ses protagonistes. Admiratif de la modernité de son approche, Jean-Luc Godard compare Moi, un Noir à “un pavé dans la mare du cinéma français comme en son temps Rome, ville ouverte dans celle du cinéma mondial”. Son œuvre des années 60, à l’instar de La punition (1962), Les veuves de quinze ans (1964) et surtout Gare du Nord (1964), confirme que Jean Rouch appartient bel et bien à la Nouvelle Vague.
En 1960, Rouch coréalise Chronique d’un été avec le sociologue Edgar Morin, illustrant le premier essai de “cinéma-vérité” selon l’expression du cinéaste. Observation du Paris de la décolonisation, le film met, là encore, largement à contribution les personnes rencontrées. Bien plus, il est tourné avec les nouveaux outils légers du documentaire : son direct et caméra portée 16 mm. Et pourtant, malgré sa portée scientifique, les films de Jean Rouch n’ont rien d’austère. Bien au contraire, il s’en dégage une fantaisie et une humanité qu’on n’associe pas en général au documentaire ethnographique. Il se livre lui-même devant la caméra de Jean-André Fieschi pour son portrait Mosso Mosso (1999) où on l’entend avec bonheur affabuler et se réinventer, comme Edward G. Robinson dans Moi, un Noir. Rouch disparaît au Niger dans un accident de la route à l’âge de 86 ans.