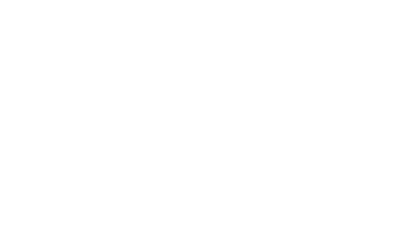A propos du film par Peter Greenaway :
J’ai pendant longtemps résisté à l’idée de réaliser un film d’art classique européen qui pour moi, tel que je le voyais alors, se rapportait trop au fait d’écrire des scénarios littéraires, de traiter la narration en des termes convenus et prévisibles, de réduire le vocabulaire filmique et d’obéir à toutes les vérités narratives orthodoxes. Cependant, on m’a persuadé, et même défié, de créer un monde dans lequel les personnages ne parleraient plus directement dans un micro ou face à la caméra, comme dans mes premiers films d’essai, mais à d’autres personnages. Le résultat est Meurtre dans un jardin anglais, bien que je n’avais pas complètement renoncé à mes préoccupations antérieures. C’était un formalisme différent , faisant appel à la raideur, à la théâtralité et au manque de naturel d’une pièce de la Restauration, usant de dialogues élaborés qui souvent, mais jamais complètement, menaçaient de braver la compréhension en raison de traits d’esprit prolongés et de jeux de mots complaisants, et tirant partie d’une musique qui annonce en permanence sa présence comme s’il s’agissait d’une pièce de concert existant par elle-même et ne remplissant pas les obligations de la musique d’ambiance d’un film.
D’une certaine façon, Meurtre dans un jardin anglais, c’est Vertical Features Remake (dans The Early Films of Peter Greenaway part 2) avec des acteurs. Avec sa camisole démesurée de paysages anglais, c’est un autre « film catalogue », cette fois avec des acteurs parcourant le monde, mais des acteurs se comportant sciemment comme des statues ou des mannequins, rassemblés dans un régime strict de temps et d’espace.
Le film se déroule en 1694 et traite de la conspiration d’un meurtre, plus dans la veine de Patricia Highsmith que celle d’Agatha Christie, avec des personnages décadents, des aristocrates provinciaux dans une ambiance douce-amère. L’exploitation sexuelle est primordiale. Le dessinateur exige des faveurs sexuelles en échange de la pratique de son art dans un manoir: un contrat pour douze accouplements imaginatifs avec la maîtresse de maison en échange de douze dessins prosaïques, satisfaisant son plaisir prédateur dans la perspective de son programme. On pense que le dessinateur est en position de force et l’on observe la progression de de son exploitation sexuelle avec un certain respect, car c’est un immoraliste impénitent, il est beau, élégant, c’est un défavorisé qui veut entrer chez les riches, un artiste de quelque talent même s’il manque d’imagination.
Cependant, le film inverse l’ordre des choses, et le prédateur devient la victime. Le comment et le pourquoi, si l’on ne devine pas le complot organisé par des femmes s’accrochant à l’héritage d’une maison d’eunuques virtuels, deviennent clairs dans les dernières minutes avec le treizième dessin et la treizième copulation. La véritable commande passée à l’artiste n’est pas de dessiner mais d’engendrer. Ses prouesses en tant qu’étalon sont mieux comprises et plus appréciées que ses prouesses en tant que dessinateur.
C’est un film de Catholiques et de Protestants, d’intérieurs et d’extérieurs, de manières et de snobisme, d’initiés et de profanes, et des diverses équations manipulatrices du sexe, de l’argent, du pouvoir et de l’art qui se jouent dans des paysages du Wiltshire anglais idéalisé aux couleurs codifiées que sont la blanc, le noir et le vert.
C’est évidemment une fiction, mais 1694 fut l’année du premier Acte de Propriété pour une Femme Mariée, de la création de la Banque d’Angleterre et l’année où Guillaume d’Orange le protestant a renforcé la position anti-catholique en Angleterre, quelques années après la Bataille de la Boyne. L’Angleterre avait changé. L’histoire moderne commençait. Bien que divertissant, et aussi éducatif que je puisse l’espérer, c’est surtout une élaboration de la prémisse originale du film qui est : un artiste doit-il dessiner ce qu’il voit ou ce qu’il connaît?
La vue et la connaissance ne sont pas du tout la même chose. Voir et croire. Le fait d’avoir des yeux ne signifie pas que l’on puisse voir. L’oeil est plus paresseux que le cerveau. A cause de telles contradictions et insuffisances, le dessinateur est victime d’un « coup monté », dans les deux sens de cette expression. A cause du matériel optique omniprésent du film, une image sur un chevalet, et à cause du découpage obsessionnel en phonogrammes qui fait le film, nous aussi sommes dans ce « coup monté ». Et nous savons que le cinéma lui-même est un outil permettant les »coups montés », dans les deux sens du terme.
L’argument selon lequel voir et savoir n’est pas la même chose pourrait souvent être mis à profit dans le cas du cinéma. En définitive, Meurtre dans un jardin anglais aurait peut-être dû s’intituler Meurtre sur un tournage anglais. Quel avantage un cinéaste tire-t-il de ne filmer que ce qu’il voit en lieu et place de ce que lui et ses spectateurs savent indubitablement ?
Peter Greenaway